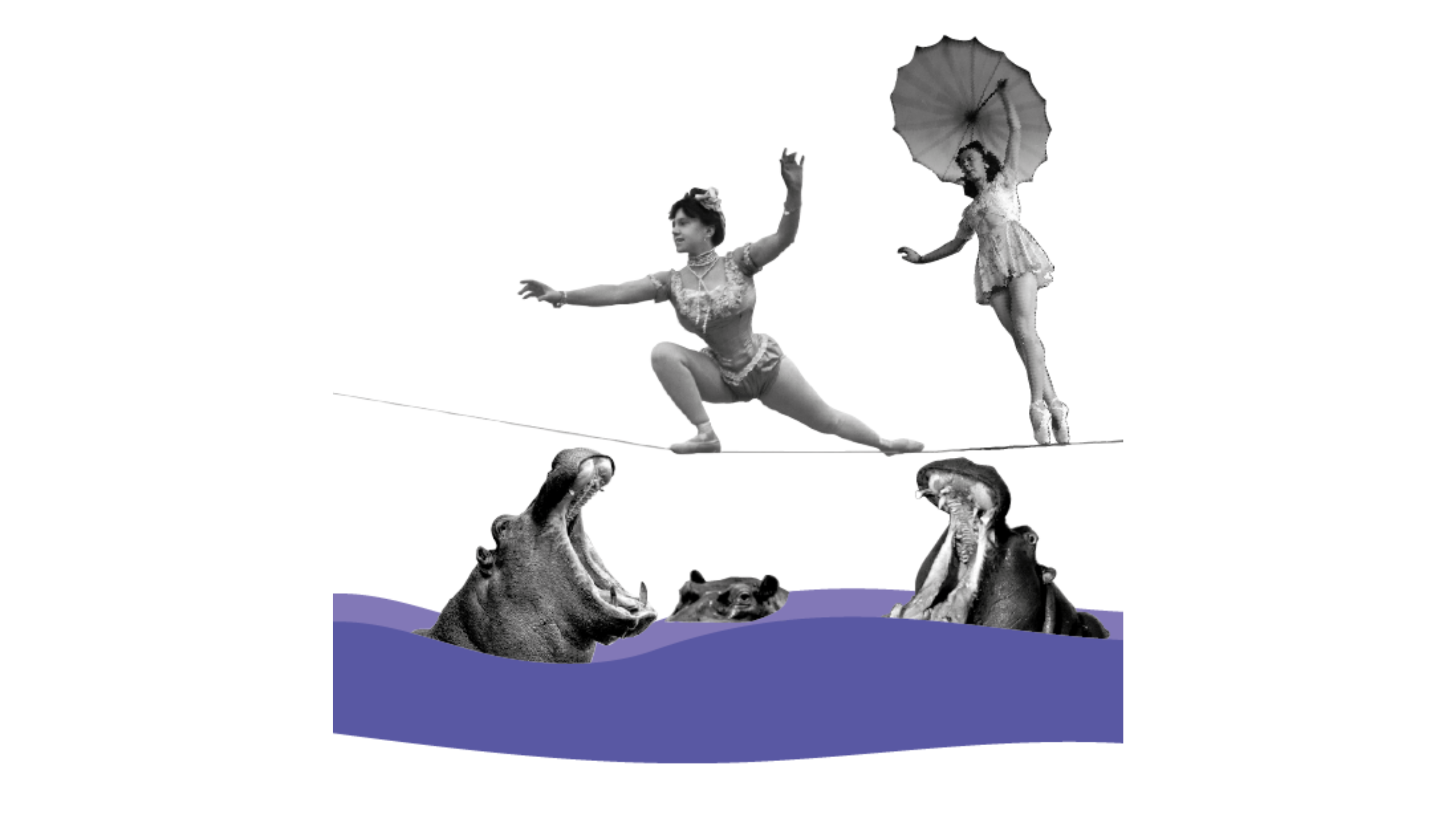
Le cri des coquelicots recueille, lors d’une journée à la côte belge, les paroles de quelques femmes (ex-)toxicomanes vivant des situations de précarité. Réalisé par la vidéaste bruxelloise Elisa VDK entourée de Sophie Godenne et de Mélissa Laurent, infirmière et travailleuse sociale à l’asbl Dune, ce film porte avec sensibilité la voix de ces femmes, d’ordinaire invisibles et nous montre la double peine que la société leur inflige. Il offre des portraits de femmes aux parcours difficiles, précaires, mais toujours dignes, fortes malgré la violence subie dans un monde inégalitaire encore plus flagrant et injuste lorsque qu’on le vit dans la peau d’une femme. Rencontre avec Elisa VDK, Sophie Godenne et Mélissa Laurent autour de la précarité au féminin. Propos collectifs recueillis par Karine Garcia et Edgar Szoc
« La précarité est d’abord féminine, liée aux inégalités de genre et à la place des femmes dans la société »
« La première chose qui compte pour elles, c’est la question du jugement, le regard qu’on leur porte. »
« Nous donnons le matériel de consommation, mais ça n’empêche pas les femmes d’aller consommer dans une station de métro, entre deux rails. »
Prospective Jeunesse : Le film suit un petit groupe de femmes lors d’un voyage à Ostende. Que signifiait ce voyage pour elles ?
L’idée était de passer une chouette journée ensemble et de se reconnecter, de faire une virée à la mer, de se poser sur une plage. De s’aérer et de sortir d’une vie parfois lourde pour elles mais aussi pour les travailleuses de l’association. Nous ne souhaitions pas faire un film misérabiliste avec des témoignages violents. On voulait sortir de la stigmatisation et montrer aussi la joie et le partage. Sans jugement. Et puis le fait de partir à la mer, au soleil, a eu comme effet, pour la plupart, de ne pas consommer. Sortir de leur contexte quotidien a été très bénéfique pour elles.
P.J. : Pourquoi un film spécifique aux femmes ?
On est parties du constat qu’il existait peu de documentation qui abordait la question du genre et de la consommation de drogues combinée à la précarité des femmes en Belgique. Il arrive que ces femmes soient sollicitées par des journalistes, par des étudiant·es, des chercheur·ses, mais ne se sentent pas toujours respectées dans l’échange et n’ont pas d’information sur le résultat final, qu’il s’agisse d’un film, d’un article dans un journal ou d’un article scientifique.
Comme nous rencontrons un certain nombre de femmes à Dune on a pensé à un film en co-construction avec elles. Un recueil de témoignages, qui leur permettrait de rendre compte de leur réalité, de leur rendre la parole en tant que protagonistes de leur vie. Nous souhaitions aussi déconstruire les stéréotypes et les préjugés qui sont encore beaucoup trop véhiculés dans la société à propos de la consommation et de la précarité.
P.J. : En quoi un film sur la même thématique mais avec des protagonistes hommes serait différent ?
C’est la question du genre. Il était important de montrer à quel point être une femme en rue avec les difficultés liées à la consommation est compliqué. La discrimination et la violence sont plus importantes pour des femmes dans une société patriarcale, capitaliste, validiste. La législation, la répression en lien avec l’usage de drogues, est plus stigmatisante que pour les hommes. D’ailleurs, elles ont beaucoup plus de réticences à venir demander de l’aide et des soins. Dans nos services, sans condition d’accès, on a entre 10 et 15 % de femmes. Une basse fréquentation qui est peut-être due à la peur de la stigmatisation et du jugement de ce milieu très masculin. Elles vivent beaucoup de violences, parfois dès l’enfance. Ces situations les ont parfois conduites aux ruptures familiales, à la consommation et au sans-abrisme. Il était essentiel de leur laisser la parole afin de raconter comme elles le voulaient, leurs réalités de vie. L’importance aussi, après le processus de tournage, de leur laisser le choix de ce qu’elles avaient envie de garder ou de ne pas dévoiler.
P.J. : Leur rapport à l’expression est-il différent ? Etant moins socialisées à prendre la parole publiquement, la stigmatisation étant plus forte lorsqu’on est consommatrice femme, avez-vous eu des difficultés à obtenir des témoignages ?
Tous les lundis soir se tient à Dune un « espace femmes », en parallèle de l’accueil communautaire. Cet espace a été créé en raison du faible pourcentage de femmes qu’on accueille. On s’est rendu compte de l’importance de créer un espace sécure pour elles. Pour ne pas reproduire les dominations, les violences, libérer la parole et pouvoir aussi valoriser leurs savoirs, leurs expériences, travailler sur l’estime de soi, ou tout simplement s’exprimer car beaucoup de ces femmes sont très isolées. Cet espace leur permet de se reconnecter entre elles ou avec des personnes extérieures à leur quotidien.
Il n’y a pas eu de refus de participation a priori. Nous leur avons montré des images filmées qu’elles ont visionnées. Certaines ont souhaité couper certaines séquences ou préféré être floutées. D’autres, moins à l’aise au départ, ont commencé à prendre part aux discussions et étaient finalement assez enthousiastes d’être filmées car elles savaient qu’elles auraient un droit de regard sur les images. Un lien de confiance est né et c’est ce qui a permis l’aboutissement du film. Sans lui, la mise en place du projet aurait été plus longue.
Les seules difficultés ont eu lieu avant le bouclage, car comme nous souhaitions qu’elles aient un droit de regard, il a été parfois compliqué de les contacter, les rassembler, le film n’étant pas une priorité dans leur vie précaire, parfois sans téléphone.
P.J. : Les trajectoires d’arrivée à la rue sont-elles différentes pour les hommes et les femmes ?
Ce n’est pas une surprise, la précarité est d’abord féminine, liée aux inégalités de genre et à la place des femmes dans la société. Les femmes sont souvent moins bien payées ou ont des contrats à mi-temps. Elles s’occupent des enfants ou ont une petite retraite. Le parcours n’est pas le même pour toutes mais il y a des similitudes. Des traumatismes, des violences sexuelles, physiques, psychologiques dans l’enfance qui se poursuivent à l’âge adulte et les rendent plus vulnérables encore. Ce n’est pas toujours la toxicomanie qui les mène à la rue : la consommation représente une sorte d’antalgique à leur détresse, un moyen de survie.
Beaucoup évoquent une première consommation dans le cadre d’une relation amoureuse. Les femmes viennent rarement seules chez nous : elles sont souvent accompagnées d’un homme avec qui elles sont en relation ou qui les « protège ». Même si cette protection n’est pas toujours bienveillante, elles disent en avoir besoin face à la violence des autres. Ce sont souvent les hommes qui viendront chercher le matériel pour consommer, achèteront le produit pour elles, le prépareront. Cette présence masculine est une des raisons pour lesquelles il est difficile de créer un lien. Lorsqu’une femme vient accompagnée d’un homme, celui-ci l’attend et met une certaine pression. Il y a une dépendance au produit et parfois une dépendance à la relation affective. Pour y remédier, nous avons développé le projet d’une soirée mensuelle où tous les services de l’asbl seraient accessibles uniquement aux femmes afin de pouvoir organiser leurs activités.
P.J. : Comment cet accueil spécifique et le film ont-ils été vécus par les hommes ?
Nous communiquons à l’avance sur la soirée mensuelle en non-mixité et la plupart des réactions sont positives. Lorsqu’ils ne comprennent pas, on leur explique la situation particulière des femmes en rue et ils acceptent. Parfois ils expriment l’idée d’un espace pour eux et on leur fait voir que l’espace est déjà masculin. Mais bien sûr, l’idée d’un espace bien-être spécifiquement dédié aux hommes, à l’estime de soi, à son image est compréhensible. Si on veut tendre vers plus d’égalité dans nos services, on a besoin de moments en non-mixité pour ne pas reproduire la domination et les violences.
P.J. : Quel a été le déclic qui a poussé à la création de cet espace non-mixte en 2018 ?
C’était le constat que très peu de femmes venaient ici, qu’on avait du mal à les accrocher. La criminalité et l’usage des drogues sont perçus comme un monde masculin. On ne considérait pas les femmes comme usagères de produits à part peut-être pour l’alcool et les médicaments. Ce qui invisibilise cette consommation féminine avec les risques sociaux et sanitaires que cela comporte.
P.J. : Quelle place occupe la maternité dans les parcours de ces femmes et que vient-elle modifier, bouleverser ?
C’est une question que nous ne voulions pas aborder d’emblée parce qu’elle fait partie de toutes ces associations de rôle, d’attribution de la maternité et de la parentalité aux femmes : ce sont elles qui ont choisi de l’aborder.
Lorsqu’elles ont encore la garde de leurs enfants, elles ont peur de venir dans les structures comme la nôtre. La loi de 1921 est très criminalisante et les femmes ont donc peur de parler de leur consommation. La plupart n’ont plus la garde de leurs enfants : elles n’ont souvent plus de droit de visite et en parler est difficile puisqu’il s’agit de revenir sur une stigmatisation comme mères défaillantes. Elles portent beaucoup de culpabilité et de tristesse
P.J. : Quelle est la première aide que ces femmes devraient recevoir et qui leur manque au quotidien ?
La première chose qui compte pour elles, c’est la question du jugement, le regard qu’on leur porte. Elles ne se sentent pas respectées. Lorsqu’il y a de la tolérance, de l’écoute, on peut commencer à travailler ensemble.
Travailler sur les déterminants sociaux est essentiel : la santé, l’accès au logement, aux revenus, au bien-être. Tant que les moyens ne sont pas mis en place, on aura beaucoup de mal à avancer. La loi de 1921 devrait être revue. Une fois que le cadre légal aura changé, on pourra travailler autrement. Il faudrait aller plus loin que le modèle portugais et sortir complètement de la logique pénale : la plupart des personnes qu’on rencontre ont une expérience carcérale. On sait aussi que la prison est un lieu où il y a de la consommation. Parfois, certaines personnes y débutent leur consommation. Mais vu l’absence de travail de réinsertion, quand elles sortent, les personnes se retrouvent exactement dans le même environnement, dans les mêmes conditions de vie et finissent par faire des aller-retours en prison. Changer la loi permettrait d’accompagner plus adéquatement, avec un coût moindre pour la société.
D’un point de vue matériel, la réduction des risques consiste aussi à définir un endroit de consommation. Nous donnons le matériel de consommation, mais ça n’empêche pas les femmes d’aller consommer dans la station de métro de la porte de Hal, entre deux rails. Elles ont peur du regard des autres mais aussi de la police et de la prison. Voilà comment elles se retrouvent à consommer de manière absolument pas hygiénique par peur de représailles judiciaires. Changer la loi permettrait de développer davantage de services et de salles de consommation. Il y en a à Bruxelles et à Liège, mais la loi ne le permet pas. Des dérogations ont été obtenues, mais un risque pénal pèse toujours sur les travailleur·ses.
Avec un changement de la loi, notre travail resterait le même mais on aurait la possibilité d’aller plus loin, d’avoir plus d’informations sur le vécu des personnes : nous avons beau être dans le non jugement et offrir un service anonyme et gratuit, une certaine méfiance subsiste malgré tout, du fait de la répression.
P.J. : On voit que beaucoup de femmes préfèrent dormir dans la rue plutôt que d’aller dans des centres où subsiste une violence et un risque d’agression sexuelle. Y a-t-il des endroits où elles peuvent se reposer sans risques ? Des dortoirs non mixtes ?
Il y en a quelques-uns mais il manque des structures d’urgence et d’hébergement. Il n’y a pas assez de places. Et quand on appelle un refuge pour victimes de violences, le fait qu’on soit associé·es à l’usage de drogues peut être un obstacle. Ces structures ne se considèrent pas outillées pour accueillir des personnes victimes de violence et usagères de drogues. Il n’y a pas assez de place en règle générale, mais pour ce public-là, c’est encore plus compliqué.