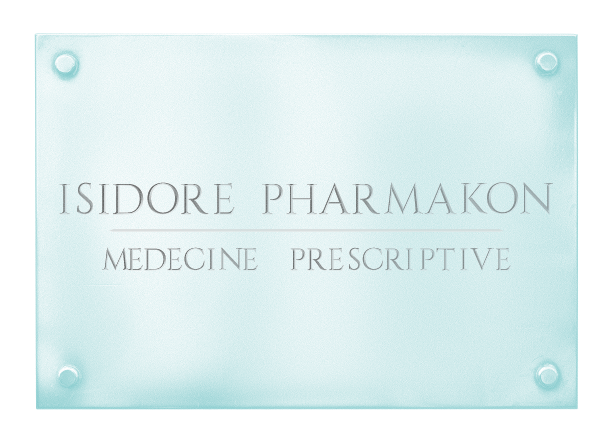
Comment soigner sans médiquer ? C’est tout l’enjeu de la pratique du psychiatre Philippe Hennaux, qui revient ici sur les raisons sociales de la hausse continue de la prescription de médicaments psychotropes. Ces propos touchent à sa pratique privée, et pas à celle de directeur médical de l’asbl L’Équipe, sauf lorsque c’est explicitement mentionné.
Propos recueillis par Edgar Szoc
Prospective Jeunesse : Quel est le rapport que vous entretenez à la prescription en tant que psychiatre ?
Philippe Hennaux : En privé, je ne prescris jamais. C’est notamment lié à ma formation de psychanalyste. On sait que les psychanalystes ne sont pas particulièrement connus comme prescripteurs – même s’il y en a qui le font. Si j’ai décidé de faire ce choix, c’est aussi parce que tellement de médecins prescrivent que ce n’est pas nécessaire : quelqu’un qui a besoin ou envie de médications les trouve très facilement. Et ceux de mes patients qui font ce choix sont libres de le faire, ce n’est simplement pas moi le prescripteur. Je leur fais simplement remarquer que s’ils guérissent, ils ne sauront pas pourquoi et par qui : eux et moi ou un produit chimique ?
Il est important de rappeler que ce ne sont d’ailleurs pas les psychiatres qui sont les plus grands prescripteurs des 12 millions de boîtes d’antidépresseurs et 6 millions de boîtes de neuroleptiques qui sont prescrites en Belgique chaque année.
En institution, par contre, j’ai beaucoup prescrit : la prescription fait partie intégrante du travail du psychiatre institutionnel et le cadre d’une institution n’est pas celui d’opinions personnelles ou d’une forme de militance, les médicaments font partie de la vie des patients, et comme pour tout médicament vous devez adapter les dosages pour éviter les surdosages et les sevrages, chez nous toujours avec le consentement du patient et en fonction de son avis, en ce compris le respect de sa volonté éventuelle de se passer de médicaments. C’est pourquoi, pour respecter le droit du patient, vous devez lui présenter des façons prudentes d’arrêter un médicament et lui proposer des alternatives thérapeutiques. Ces alternatives existent.
Ce ne sont pas les psychiatres qui sont les plus grands prescripteurs des 12 millions de boîtes d’antidépresseurs et 6 millions de boîtes de neuroleptiques qui sont prescrites en Belgique chaque année.
PJ : Qu’est-ce qui vous a amené à adopter cette attitude qui peut sembler radicale ?
Tout d’abord, je ne pense pas que ma position actuelle soit radicale, mais parfois, il faut s’exprimer de façon tranchée pour susciter la réflexion et accepter le mésusage qui peut être fait de vos paroles hors contexte, ou discrètement transformées.
Pendant ma formation, j’étais fasciné par la biochimie, en particulier ses applications dans la compréhension biologique de ces cellules qu’on appelle neurones, ainsi que des neurotransmetteurs, avec l’idée, courante à l’époque, qu’on allait à partir de là bientôt tout comprendre du fonctionnement du cerveau. C’est au moment de la fin de mes études que sont sortis les antidépresseurs de nouvelle génération, du type Prozac et ensuite les nouveaux neuroleptiques, qui marient les effets neuroleptiques classiques avec des effets stimulants.
C’est précisément parce que je connaissais assez bien les moyens d’investigation neuroscientifiques – et leurs limites – qu’il m’a semblé que, pour des raisons commerciales évidentes, on faisait passer de certes séduisantes théories pour des vérités « scientifiquement prouvées ». Pour me faire bien comprendre, je trouve normal et stimulant la création d’hypothèses, leur diffusion ou leur éventuel succès public. Mais les transformer en vérité estampillée scientifique et en dogme est un pas que je me suis pas résolu à franchir.
Lors de mes études, la dépression était envisagée sous la forme de la mélancolie – des cas très graves et spectaculaires d’apathie extrême, qui étaient traités en contexte hospitalier par des antidépresseurs tricycliques, d’ancienne génération, lents à agir et avec des effets secondaires que nous connaissions bien et dont il fallait se méfier. Ces médicaments se prêtaient mal à une pratique ambulatoire et ne s’adressaient absolument pas à l’humeur de l’ensemble de la population. Or, avec le succès, par exemple, de cette théorie basée sur la recapture de la sérotonine, les « dépressions » ont commencé à proliférer – d’autant plus qu’il y avait désormais une molécule pour les traiter, et des gens pour s’autodiagnostiquer, avec un élargissement considérable du concept de « dépression », qui avec celui de stress a fini par englober tout mal-être que peut ressentir un être humain. En tout cas, jusqu’à l’arrivée du concept de burnout, qui, par son aspect plus relationnel et contextuel, me paraît plus intéressant cliniquement. Un patron trop exigeant, un travail trop difficile, un proche trop malveillant, cela me paraît plus réel qu’un manque de sérotonine.
Avec le succès de cette théorie basée sur la recapture de la sérotonine, les dépressions ont commencé à proliférer.
Le mystère du cerveau
Comment fonctionne le cerveau ? Et comment fonctionnerait un cerveau « pathologique » ? Ces questions sont à ranger parmi les grands mystères, comme l’origine de la vie sur Terre, l’apparition de l’homme, l’apparition du langage, la naissance de l’univers, ainsi que le destin qui leur est réservé. Ce sont les grands mystères qui justifient leur approche par la méthode scientifique. Lorsqu’on n’arrive pas à tout savoir tout de suite à cause de la complexité d’un sujet, il est évident qu’il faut recourir à des théories, construire des hypothèses.
Je viens de lire dans le New York Times un article qui annonce que les théories en vigueur jusque-là sur la Matière noire étaient fausses. C’est une bonne nouvelle, car la théorie en question prédisait la fin de l’univers. Quand je vois que les physiciens, qui selon moi sont à la pointe de ce qu’on appelle « la recherche » en science, sont capables de remettre en cause leurs théories – plus encore : qu’ils désirent ardemment le faire et se montrent contents quand ils y arrivent –, je me prends à rêver que les psychiatres aient le même état d’esprit.
En psychiatrie, en psychologie, en neurosciences en général, les théories abondent, jusqu’à se contredire non seulement entre elles, mais à l’intérieur de leur propre cadre, mais les vérités sont rares (on a un corps/on parle/nous sommes des êtres sociaux/les relations que nous avons nous construisent/nos symptômes sont liés à notre histoire particulière et ils apparaissent dans un contexte précis) et on doit souvent se contenter de faire fonctionner des demi-vérités comme si elles étaient des entités objectives. J’insiste sur ce point, que de formuler une hypothèse quand on a un patient devant soi est une nécessité intellectuelle, déontologique et la base de tout projet thérapeutique ; ce qui me dérange, c’est quand l’hypothèse devient une vérité dont on ne doute pas et qu’on a du coup tendance à imposer, comme s’il n’y avait pas d’autre solution et qu’il ne servait à rien de discuter.
Une prolifération de « troubles mentaux »
Pour expliquer cela, il faut faire un détour par des questions fondamentales : Qu’est-ce que la médecine ? À quoi sert-elle ? Qu’est-ce qu’une maladie ? À quoi la reconnaît-on ?
Ces questions se sont complexifiées ces dernières années : par exemple le concept de maladie peut aujourd’hui aussi bien être compris comme « ce dont quelqu’un se plaint » que comme « ce que découvre le médecin par un examen clinique alors que le patient ne se sent pas malade ».
Depuis la fondation de la médecine comme telle par Hippocrate, et ce point a été la base de la fondation de la médecine scientifique bien plus tard, le concept de maladie « idéal » repose sur un trépied : symptômes, signes et examens complémentaires. Car comme écrit Hippocrate : « le problème des maladies est qu’elles sont invisibles ». Pour un médecin l’oreille c’est bien, mais l’œil c’est mieux.
Quand un patient va voir un médecin, ce sont les symptômes qui l’y poussent : fatigue, douleur, mais aussi angoisse, tristesse, peur… Les symptômes sont la voie d’entrée, ce sont les éléments de base de communication et de transmission d’un malaise.
Les signes sont recherchés par le médecin, lors de l’examen physique du patient, dans toute sa méticulosité. Ces signes peuvent être présents à l’insu du patient, et il est certain que ni le discours du patient ni celui du médecin n’ont d’effet sur la présence ou non de ces signes. C’est pourquoi on les qualifie d’objectifs alors que les symptômes sont habituellement qualifiés de subjectifs.
Enfin, d’autres corrélats objectifs peuvent être relevés par d’examens comme la prise de sang ou la radiographie, corrélats qui sont non discursifs et non subjectifs.
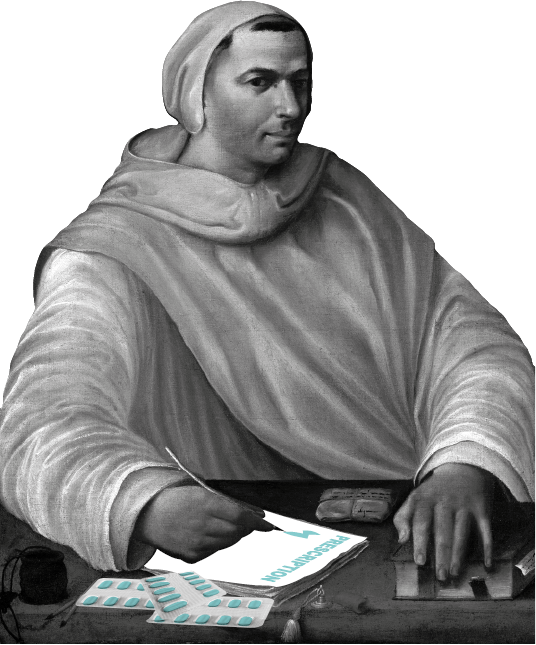
Du point de vue épistémologique, toute maladie est nécessairement d’abord une construction mentale nécessaire au médecin pour élaborer une hypothèse de cause et donc de traitement.
Du point de vue épistémologique, toute maladie est nécessairement d’abord une construction mentale nécessaire au médecin pour élaborer une hypothèse de cause et donc de traitement. Plus on trouve d’éléments objectifs comme des signes, des anomalies biologiques ou radiologiques, plus l’hypothèse peut être considérée comme juste et efficiente, et le médecin traiter à coup sûr.
Or, en psychiatrie, les signes font généralement défaut: schizophrénie, dépression, burnout, stress, ne sont pas attachés ni attachables comme tels à des corrélats objectifs. On les cherche en vain. Nous ne pouvons que nous en tenir aux symptômes, et nous résoudre à construire le concept de maladie en psychiatrie sans corrélat objectif.
Cela ne nous empêche pas d’espérer le trouver (la prise de sang qui… le test de provocation qui… l’imagerie cérébrale qui… le gène qui…), espoir sans cesse promis puis déçu, puis renouvelé, puis à nouveau déçu… Mais rappelons-nous que chaque fois qu’on trouve des corrélats objectifs à une maladie jusque-là traitée par la psychiatrie, elle en quitte le champ. C’est par exemple le cas pour l’épilepsie, partie vers la neurologie, pour la démence, qui a suivi le même chemin, pour l’ulcère gastrique et l’allergie, présentés encore il y a 40 ans comme des « maladies psychosomatiques » et qui sont désormais très bien traités par d’autres spécialistes, sans recours à la psychologie ou à la médication psychiatrique.
Au demeurant, je n’ai pas beaucoup de mérite à décrire ce que d’autres ont montré beaucoup mieux que je ne peux le faire : la création du DSM-III en 1980 est une tentative véritablement scientifique de résoudre le problème du manque de corrélat objectif en psychiatrie. Son créateur, le Dr Spitzer, constatant comme bien d’autres ce défaut constitutionnel de la psychiatrie et le trouvant bien peu scientifiquement défendable, a simplement remplacé le concept de « maladie » par le concept de « trouble », dans le but de créer une sorte d’objectivité de raccroc, de pansement conceptuel, le nouveau « diagnostic » reposant sur une série de symptômes présents en même temps, choisis dans une liste écrite à l’avance. Comme il définissait un « trouble » par « ce qui peut déranger quelqu’un » ou « ce qui peut déranger les autres », il lui a été possible de ne pas faire rentrer l’homosexualité dans le répertoire des troubles, ce qui était une excellente nouvelle, mais d’y faire entrer nombre d’entités qu’il aurait été bien difficile de faire admettre auparavant comme « maladies », corrélat objectif oblige. Il est dommage que peu de professionnels aient été prévenus, ou aient remarqué, qu’à partir des années 80 la psychiatrie, et avec elle la médecine et la santé mentale, est entrée dans un nouveau monde, où le concept de maladie avait cédé la place au concept de trouble, et que le traitement d’un trouble n’équivalait pas exactement au traitement d’une maladie.
Une autre motivation à cette attitude que vous appelez « radicale », c’est qu’il faut être là pour les « alternatifs » : les gens qui ne veulent pas entendre parler des médicaments, ou plus spécifiquement des médicaments psychotropes, pour des raisons qui leur appartiennent. Ces gens-là ont le droit d’être reçus, écoutés et traités au même titre que les personnes qui souhaitent des médicaments. Les personnes qui viennent me voir en cabinet privé savent bien que je ne prescris pas et c’est la raison principale pour laquelle ils viennent me voir. Et c’est pourtant bien un médecin qu’ils veulent voir assis devant eux.
À partir des années 80 la psychiatrie, et avec elle la médecine et la santé mentale, est entrée dans un nouveau monde, où le concept de maladie avait cédé la place au concept de trouble.
PJ : Pourquoi traiter sans médicament ?
Il me paraît bizarre d’intervenir sur quelque chose qui est de nature uniquement symptomatique, et donc discursif, socialement construit et médié, par quelque chose d’aussi sérieux qu’un produit qui, comme l’écrivait Castaneda, est en tant que médicament à la fois poison et remède. Au moment de prescrire en psychiatrie, il faudrait donc peser très attentivement le « pour » et le « contre » et il me semble que cet arbitrage est très insuffisamment effectué, et que s’il l’était, le « contre » l’emporterait très fréquemment sur le « pour ». Il y a une grande méconnaissance des effets positifs et négatifs de ces médicaments, non seulement chez les patients, mais aussi chez les médecins : on a tendance à maximiser les effets positifs et à réduire à pas grand-chose les effets négatifs – ils sont indiqués dans la notice, mais ils le sont tous, par ordre de fréquence, ce qui rend le patient très perplexe à sa lecture. Qui plus est, quand un médicament ne donne pas les effets escomptés, au lieu de chercher une autre piste, on double la dose, on attend longtemps, on change de médicament, et si rien ne marche et que le patient se plaint, au lieu de se poser la question de l’intérêt du traitement, on parle de « résistance au traitement ». Ce qui laisse l’impression désagréable que, sans prescription de psychotropes, un psychiatre serait complètement impuissant devant un tableau clinique. Ce n’est pourtant jamais le cas.
Créer du lien
Pour répondre finalement à votre question sur le traitement sans médicament : on crée du lien, de façon durable. Ce qui peut amener les gens à ne pas se sentir bien est d’origine contextuelle, historique et sociale, et pas biologique. Et le remède se doit donc d’être contextuel, historique et social, et pas biologique. La phrase de Pierre Dac résume finalement assez bien ce travail : « Si tu ne te sens pas bien, va te faire sentir par quelqu’un d’autre ». Mais il faut accepter de répondre à des questions complexes par autre chose que des réponses simples et immédiates.
Nous ne sommes pas des victimes de notre cerveau : le mal-être n’est pas nécessairement lié à un déficit de sérotonine. Nous avons une histoire, nous vivons un contexte, au sens étroit, un contexte intime, comme large, le contexte étendu aux limites de la société. Cette histoire, ce contexte, nous pouvons en souffrir, et le manifester par des mots et des attitudes. Ce qui est causé par des liens sociaux et par des discours peut aussi être traité par d’autres liens sociaux, nouveaux, meilleurs, et par d’autres paroles, d’autres expériences sociales et relationnelles. Le traitement est ici aussi orthodoxe par rapport à l’hypothèse causale.
Par ailleurs, il y a également tout un travail de déstigmatisation à mener, pour ne pas réduire les personnes à leurs symptômes ou à leurs traitements. Chez les « fous », comme chez les « pas fous », il y a des personnes qu’on va adorer et d’autres qu’on n’aimera pas, des personnes prodigieusement intéressantes, et d’autres profondément ennuyeuses. Plus on fréquente quelqu’un, moins l’éventuel diagnostic a de l’importance dans le rapport qu’on a avec lui. Ce travail de déstigmatisation, ce n’est ni le patient ni le médecin qui doivent le mener comme s’ils étaient seuls au monde. Rêvons un peu : c’est l’ensemble de la société.
Pour évoquer le travail de l’Équipe, et non plus ma pratique privée, nous nous inscrivons dans le courant de la psychiatrie sociale, qui s’intéresse à la socialisation du symptôme. Nous cherchons la manière de vivre en groupe qui amène le moins de symptômes possible. Au fond, il n’y a rien eu de pire que le Covid, qui a isolé les gens et qui les a rendus dangereux les uns pour les autres. Quand on observe la montée des difficultés de santé mentale consécutive à la pandémie, on se rend bien compte que le cœur du problème, ce n’est pas la sérotonine. Je crois vraiment que le groupe et le faire-ensemble sont le remède à un très grand nombre de symptômes. Ici, on rétablit du groupe et des fonctionnements de groupe, et donc des règles généralement produites par le groupe. D’une certaine façon, il s’agit de refabriquer une sociabilité menacée de disparaître.
L’Équipe
L’Équipe comprend deux communautés thérapeutiques, dont une pour usagers de produits illégaux, trois centres de jour, un hôpital de jour pour adolescents, un club d’usagers, un centre ambulatoire et un centre de documentation. Elle cogère des habitations protégées et un projet d’habitat groupé pour jeunes adultes. Elle vient d’ouvrir un lieu de liens et de fonder une équipe mobile sur la commune d’Anderlecht. Elle est aussi fondatrice d’Hermès+, asbl avec laquelle elle promeut une vision communautaire de la réforme de la psychiatrie et l’avancement de la mobilité et de la rapidité d’intervention dans le champ de la psychiatrie sociale. Elle favorise aussi une approche territoriale de proximité.
L’Équipe participe aux travaux des institutions actives en santé mentale à Bruxelles et à leurs représentations associatives ou légales (LBFSM – Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale et PFCSM – Plate-forme de concertation pour la santé mentale en Région de Bruxelles-Capitale), et elle est aussi membre active de ces associations. Elle accueille de nombreux stagiaires des Hautes écoles et des Universités. Elle collabore à l’enseignement dispensé par l’ULB. Depuis peu, elle est ouverte à l’inclusion de pairs aidants et d’experts d’expérience au sein de ses équipes.
Plus d’informations sur https://equipe.be
Nous ne sommes pas des victimes de notre cerveau : le mal-être n’est pas nécessairement lié à un déficit de sérotonine.
Plus on fréquente quelqu’un, moins l’éventuel diagnostic a de l’importance dans le rapport qu’on a avec lui.
PJ : Comment expliquer le niveau actuel de prescriptions de médicaments comme les antidépresseurs ou les neuroleptiques ?
Le discours para-scientifique représente un recours de nature quasiment religieuse pour des sujets modernes qui sont particulièrement vigilants à leurs sensations et sentiments, et cherchent des solutions simplifiantes et expéditives, très en vogue à notre époque. Je ne jette même pas la pierre aux firmes pharmaceutiques : dans les années 1980, elles ont dépensé beaucoup d’argent pour faire de la dépression une maladie comparable, par exemple, au diabète, plus grave encore, car « elle n’était pas reconnue ». Mais maintenant, elles n’ont même plus besoin de le faire pour voir leurs ventes augmenter régulièrement. Ceci dit, le médicament le plus rentable pour les entreprises pharmaceutiques, c’est celui qu’on prend le plus tôt possible, qu’on arrête le plus tard possible, qui traite mais surtout ne guérisse pas trop et pas trop vite ! Et cette formule s’applique parfaitement aux antidépresseurs et aux neuroleptiques… Or, un médicament psychotrope, comme tout autre médicament, ça devrait idéalement se prendre le moins possible, le moins longtemps possible. Au bilan, des phénomènes que notre culture considère comme des maladies sont aujourd’hui traités par des objets que cette culture considère comme des médicaments… et je crois que c’est leur plus grande source d’efficacité subjective : une société identifie, nomme des pathologies et propose une solution, fournie par ceux que cette société met en place pour interpréter ce qu’on ne peut comprendre… Comment résister ?
PJ : Quelle attitude adoptez-vous à l’égard de vos collègues « prescripteurs » ?
Ma position n’est pas critique à l’égard des collègues qui prescrivent, ni évidemment des patients qui demandent une prescription. Si vous n’allez pas bien, que vous allez voir votre médecin, qu’il ne sait pas trop bien comment vous aider quand vous souffrez et que les prises de sang reviennent normales, la prescription symbolise son souci, son empathie, le cas qu’il fait de votre situation, le désir de vous aider comme professionnel. Le phénomène ne souffre d’aucune critique, comme dans une pièce bien réglée où chacun joue parfaitement son rôle.
La position que j’ai pu développer me convient bien à moi et aux personnes qui viennent me voir, car il faut aussi penser aux soins qu’on peut apporter aux personnes qui ne souhaitent pas prendre de médicaments.
Je crois important de légitimer le choix de certains médecins de prescrire des psychotropes et de certains patients d’en prendre, mais aussi de légitimer le contraire, de rappeler que ce n’est pas toujours utile, que c’est même parfois contre-indiqué et que c’est chaque fois une affaire de rencontre entre tel patient et tel médecin. Après tout, la question du choix est essentielle en démocratie. J’insiste vraiment sur le fait que je ne donne pas de leçons. Le monde est tellement compliqué et tant de gens souffrent que, bien sûr, tout est bienvenu pour aider, si ça aide.
Mais j’insiste aussi sur le fait que je ne suis pas isolé : le gouvernement fédéral a lancé des campagnes de psychologie de première ligne, ainsi que le site usagepsychotropes.be pour « favoriser un usage rationnel des psychotropes ». L’heure n’est plus au triomphe des médicaments psychiatriques : grâce aux efforts de l’Europe, de l’OMS, de l’actuel ministre de la Santé, la vague des prescriptions diminue, mais peut-être plus pour des raisons économiques que déontologiques. Je trouve en outre que le discours qu’aujourd’hui on appellerait « droits-de-l’hommiste » améliore bien les choses : augmenter le droit des patients et le devoir des médecins de les informer, restreindre l’autorité des médecins, etc. La loi de 2002 relative aux droits des patients qui vient d’être améliorée me paraît fondamentale à cet égard, comme la position du Conseil de l’Europe que j’ai déjà mentionnée : on ne peut ni forcer à un traitement, ni même convaincre par l’autorité, en psychiatrie, pas plus qu’ailleurs. Si je souffre d’un cancer je peux refuser une chimiothérapie. Mais si je suis appelé schizophrène, pourquoi suis-je obligé de prendre un traitement qui ne m’aide pas et qui selon mon avis me rend malade ?