Evaluer: sortir du couperet
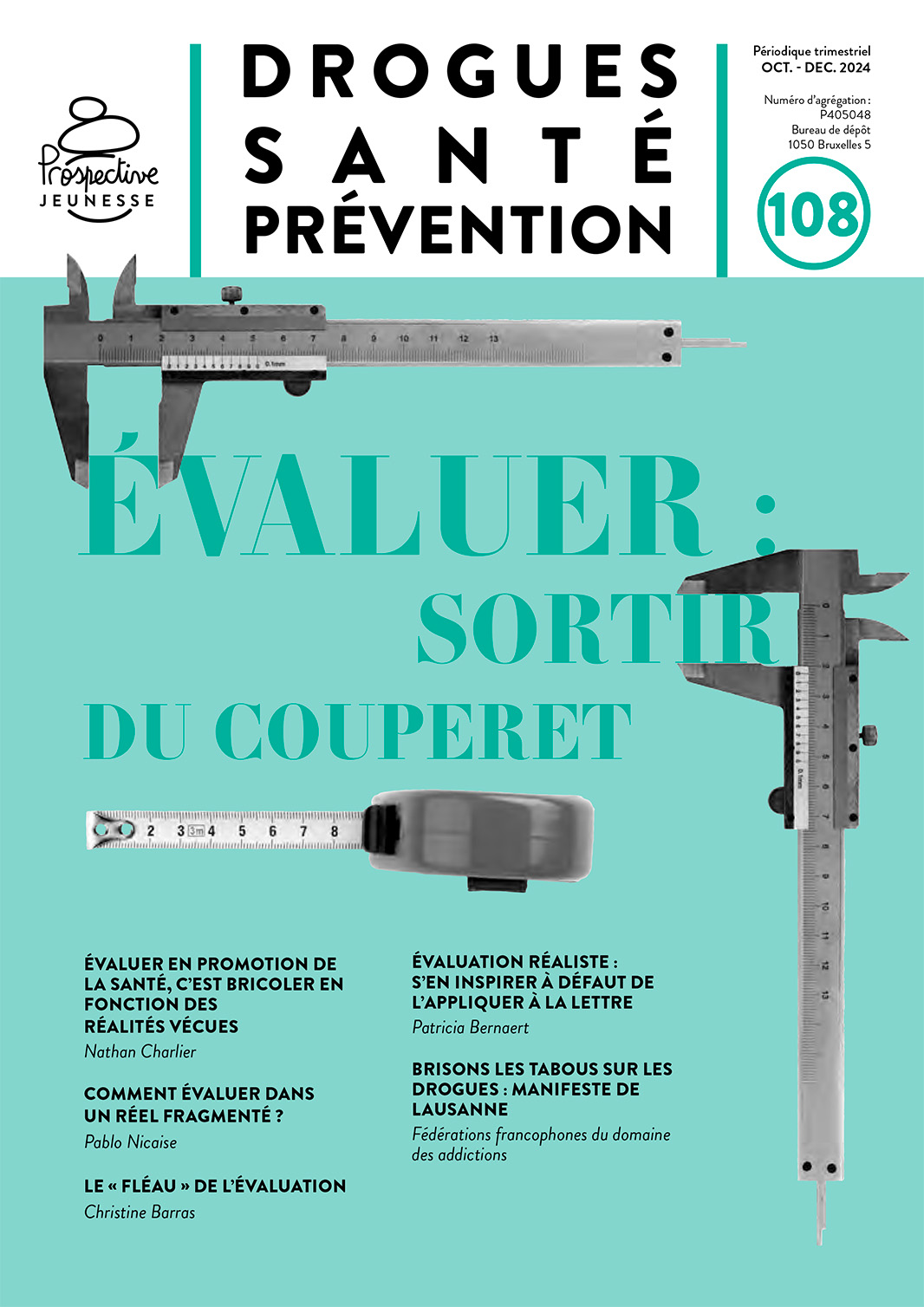
Introduction
Connais-toi toi-même et… évalue-toi toi-même ?
Évaluer une politique publique : qui s’y oppose encore sans rougir ? L’idée semble relever du bon sens le plus élémentaire. Quand les moyens fondent comme neige tiède, mieux vaut savoir ce qu’ils produisent. Montrer qu’une action de prévention ne repose pas que sur des bonnes intentions, voilà qui rassure l’élu comme le contribuable. Et sur le terrain, l’évaluation aide à ajuster le tir, à mettre en valeur les trouvailles, à abandonner les fausses pistes. Sur le papier, tout colle.
Mais comme souvent, le bon sens finit corseté dans une logique gestionnaire, où l’« impact » se mesure à la vitesse du budget annuel. La prévention, elle, refuse ce tempo. Elle travaille en amont, en douceur, parfois dans l’échec apparent. Elle désamorce, décale, répare sans bruit. Elle évite l’accident plutôt qu’elle n’en soigne les séquelles. Autant dire qu’elle se glisse mal dans un tableau Excel.
Et comme si cela ne suffisait pas, elle évolue dans un climat peu propice à la nuance. Dans un pays encore traversé par le réflexe prohibitionniste, la prévention se heurte au soupçon. Trop compréhensive, trop tiède, trop floue ? Les marges d’action rétrécissent, les messages s’affadissent, les interventions se justifient avant même de commencer. L’évaluation, là-dedans, se transforme vite en épreuve : comment prouver l’efficacité d’une parole qu’on n’a jamais vraiment eu le droit de tenir ?
Ajoutons à cela l’absurdité budgétaire. En Belgique, les entités fédérées financent la prévention, mais les bénéfices – hospitalisations évitées, prisons désengorgées – allègent les comptes… fédéraux. Et comme si le morcellement horizontal ne suffisait pas, voilà que le temps s’en mêle : investir aujourd’hui pour épargner demain n’offre aucun rendement électoral immédiat. De quoi décourager les plus vertueux. Au lieu de scruter sans fin les rapports d’activité des associations, ne faudrait-il pas, parfois, évaluer ceux qui les commandent ?
L’évaluation, pourtant, garde toute sa place. Elle guide, éclaire, renforce. Mais à condition d’éviter le pilotage à vue et la course au chiffre. Elle gagne à se décliner. L’évaluation « descendante », commandée par les autorités subsidiantes, a sa légitimité. Mais seule, elle rate l’essentiel. Ce qui transforme vraiment, c’est l’auto-évaluation. Quand les équipes prennent le temps de relire, de questionner, de confronter leurs ambitions au réel. Quand elles discutent, doutent, se remettent en jeu. Rien de plus exigeant. Rien de plus fécond.
Malgré des politiques fragmentées, sous-dotées, secouées entre niveaux de pouvoir, les acteurs de terrain continuent. Ils tissent du lien, inventent du sens, bricolent du collectif. Ils demandent qu’on les regarde, oui, mais avec justice. Ce qu’ils espèrent d’une évaluation ? Pas un couperet, mais un miroir. Pas une mise au pas, mais une prise de hauteur. Bref : un outil pour penser. Et ça, justement, ne se mesure pas.