En mai 2022, une Task force a été mise en place, rassemblant des experts des mondes associatifs et scientifiques ainsi que des administrations impliqués dans le diagnostic socio-sanitaire, dans l’analyse des références scientifiques en promotion de la santé ainsi que dans les actions et programmes actuellement développés en promotion de la santé. Fondés sur une relecture du Plan wallon de promotion de la santé et de prévention (Wapps), les travaux de la Task force avaient une triple visée : actualiser les objectifs du Wapps en fonction du nouveau contexte socio-sanitaire, notamment les leçons à tirer et les conséquences de la crise sanitaire ; sélectionner les objectifs de ce plan estimés prioritaires pour faire face aux défis à relever par la Wallonie dans les 5 prochaines années ; lier les objectifs de ce plan à ceux des plans wallons ou fédéraux, entérinés ou en construction. Les travaux de cette Task force ont été soutenus et pilotés par l’Aviq et Esprist. Estelle Georgin qui s’est chargée de cette mission pour Esprist et Nathan Charlier qui en est le coordinateur reviennent sur cette expérience et sur les spécificités de l’évaluation en promotion de la santé.
Propos recueillis par Edgar Szoc
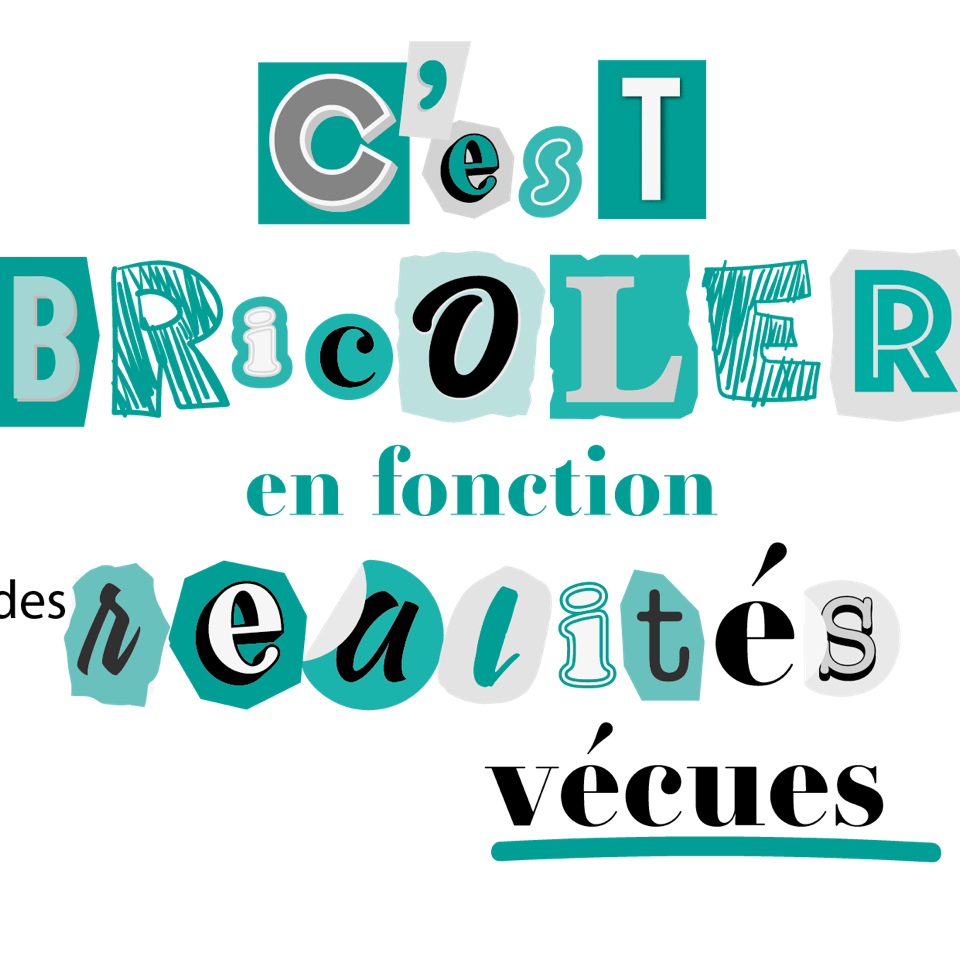
Quelle est la spécificité de l’évaluation en promotion de la santé, par rapport aux autres politiques publiques en général ?
Nathan Charlier : En matière de santé, il y a en effet une habitude de réaliser des évaluations très positivistes avec des dispositifs de type expérimental ou quasi expérimental, qui s’appliquent difficilement aux interventions complexes de la promotion de la santé et ce, pour toute une série de raisons. Il y a d’abord un enjeu de temporalité : ces interventions ont un effet dans le temps long. En agissant sur un milieu ou une population spécifique, on ne perçoit les effets potentiels qu’à très long terme. Il y a en outre des enjeux de causalité qui sont très complexes à établir. C’est toute la question de l’imputabilité : comment identifier que tel effet est lié à tel type de pratique ou d’intervention dans la mesure où les déterminants de la santé ont des influences croisées. Il y a enfin tout l’effet du contexte, et singulièrement des autres politiques menées en parallèle. Si on double le budget de la promotion de la santé, mais qu’on limite les allocations de chômage dans le temps, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour supposer des effets contradictoires.
Ce problème n’est pas présent uniquement en promotion de la santé. On n’est pas dans des conditions de laboratoire. C’est dans cette mesure que les évaluations qui se situent dans le paradigme dit « réaliste » peuvent avoir du sens[1] : elles essayent d’expliciter la logique d’intervention sous-jacente à une intervention ou à une politique publique, et d’identifier des configurations contexte-mécanisme résultats, spécifiques à certaines situations. Mais c’est évidemment plus difficile à communiquer à des responsables politiques dans la mesure où c’est sans doute moins parlant qu’un rapport simplement financier.
Estelle Georgin : Dans nos évaluations, on va toujours essayer de mettre en avant les effets observés sur les déterminants sociaux de la santé sans rechercher un effet direct sur la santé. On essaye d’identifier les intermédiaires entre une action et un effet potentiel sur la santé. Les opérateurs de promotion de la santé ont des pratiques et des publics très variés : il faut pouvoir faire preuve d’adaptabilité en fonction de ces variations. Il n’existe pas un modèle qui peut fonctionner pour tout le secteur : il faut parfois bricoler en fonction des réalités vécues dans les pratiques.
NC : Sur certains déterminants, il n’est pas besoin d’établir des preuves objectives pour évaluer l’effet sur une population : on peut travailler avec des indicateurs plus proximaux.
« Les opérateurs de promotion de la santé ont des pratiques et des publics très variés : il faut pouvoir faire preuve d’adaptabilité en fonction de ces variations. »
Par rapport à ces spécificités, que peut-on dire du Plan wallon de promotion de la santé et de prévention (WAPPS) et de sa programmation ?
NC : Il a été pensé dans une approche très participative à laquelle ont participé de nombreux opérateurs en vue d’élaborer des objectifs et des indicateurs qui aient du sens pour eux. Et quand je dis « eux », il s’agit tout autant des opérateurs que des personnes usagères.
Cette manière de travailler a évidemment eu une conséquence qui aurait pu être anticipée : les indicateurs varient d’un opérateur à l’autre et ne se recoupent que rarement. Si on additionne les différents indicateurs utilisés par chacun des opérateurs agréés, on se retrouve avec le chiffre un peu exorbitant de 2 000. Dès lors, pour avoir une vision – sans même parler d’une évaluation – globale, on se retrouve un peu démuni !
EG : J’ai l’impression que les opérateurs ont assez bien maîtrisé le Wapps, mais beaucoup moins la programmation, qui visait à lui donner un côté plus concret et à offrir des portes d’entrée plus thématiques, notamment en refondant les 120 objectifs transversaux du Wapps en 7 stratégies (Informer, sensibiliser, développer la littératie en santé et le plaidoyer ; Outiller les professionnels en stimulant les échanges de pratiques et en formant à des pratiques innovantes ; Renforcer les démarches communautaires et les approches collectives dans les milieux de vie ; Renforcer les collaborations intersectorielles dans une optique de promotion de la santé, en vue de générer des dynamiques locales qui influencent les déterminants sociaux de la santé ; Informer et collaborer pour renforcer l’accessibilité des services de prévention et de promotion de la santé ; Intégrer la promotion de la santé dans le parcours de soin).
NC : Il y a encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à trouver un dénominateur commun en matière d’évaluation. C’est notamment pour cette raison qu’Esprist organise en 2025 un cycle de séminaires consacrés à la question de l’évaluation[2].
-
Voir l’article de Patricia Bernaert dans ce numéro.
-
Le programme est disponible ici : https://www.esprist.uliege.be/cms/c_5366251/fr/esprist-seminaires-evaluation